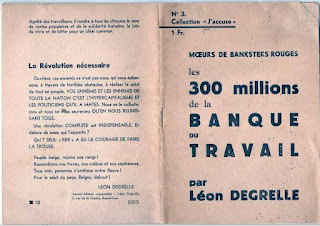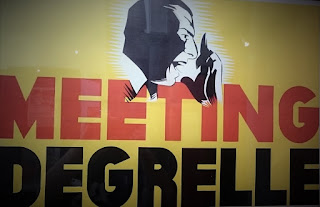|
Franz Adam, photo dédicacée : « Heil Hitler,
13 novembre 1932 »
|
Onzième enfant du peintre Emil Adam et de l’actrice Josefa Wurmb, Franz Josef Johannes Maria Adam est né le 28 décembre 1885 au domicile de ses parents, dans la Schanthalerstrasse, à Munich.
Après de brillantes études secondaires, il entre, en 1903, à l’Académie Royale de Musique de Munich, où il étudie la clarinette, le piano, la composition ainsi que la composition auprès du grand chef wagnérien Félix Mottl. En 1912, il épouse la pianiste Magdalena Nikisch, dont il aura deux enfants, Annemarie et Luitpold, mais dont il se séparera au début des années 30.
Franz Adam entame sa carrière professionnelle dans l’orchestre de l’opéra de Munich où il est clarinettiste à l’occasion du Festival Wagner de 1910. Par la suite, il sera répétiteur des chœurs et « Kapellmeister » dans de plus modestes institutions, comme Altenburg, Giessen, Bad Ems et Ragaz bei St. Gallen. En 1914, il s’engage –tout comme un certain Adolf Hitler– comme volontaire dans l’armée bavaroise.
Après la guerre, il participera à la fondation de l’Orchestre de radiodiffusion de Munich (aujourd’hui le renommé
Bayerischer Rundfunk Symphonieorchester) dont il sera le premier chef. Il le quittera à la fin des années 20 car, national-socialiste convaincu (sa carte de membre du parti porte le numéro 348.967 et la date du 1er janvier 1930), il souhaite doter Munich, « Capitale du Mouvement » de son propre orchestre national-socialiste. Et ce, dans le but de rendre aux nombreux excellents musiciens du sud de la Bavière au chômage non seulement un travail, mais un but culturel et social qui soit partie prenante du combat du Parti.
Le premier concert, triomphal, du
Nationalsozialistischen ReichsSymphonieorchester eut lieu, le 10 janvier 1932, au Cirque Krone de Munich. Au programme de la formation des 72 musiciens, pionniers de l’orchestre : l’Ouverture d’
Obéron de Carl-Maria von Weber, l’Ouverture des
Maîtres Chanteurs de Nuremberg de Richard Wagner et la Quatrième Symphonie « Romantique » d’Anton Bruckner.
C’est le 10 juillet 1932 que l’orchestre joua pour la première fois devant Adolf Hitler. C’était au
Kursaal de Berchtesgaden, à l’occasion des
Groß-Deutschen-Tages. Le concert était en fait prévu la veille, 9 juillet, mais les conditions météorologiques épouvantables empêchèrent la voiture du Führer de descendre la route des montagnes.
Franz Adam a rendu compte de l’événement en écrivant: « Notre orchestre se réjouit de remplir sa mission de concert en concert : chaque soir, sur scène, il mène un nouveau combat et emporte une nouvelle victoire pour la cause sacrée de notre Führer. La seule chose qui nous affligeait était que notre Führer, toujours absorbé par son combat, n’avait pas encore pu nous entendre. Jusqu’à ce que, ce mardi matin, dix minutes après la fin des répétitions, je reçoive une communication téléphonique m’annonçant que le Führer voulait entendre notre orchestre le lendemain soir à l’occasion des
Grandes Fêtes Allemandes de Berchtesgaden… Nous allons à Berchtesgaden dans l’enthousiasme indescriptible de tous les musiciens. Mais au début du concert, le Führer n’était pas encore arrivé à Berchtesgaden. Le chef des sections locales annonça alors au public que “le Führer viendrait directement sur place car il était fort retardé par les pluies diluviennes”. Je voyais les visages déçus de mes camarades, mais je les savais endurants… Le soir, vers 23h30, nous parvint un ordre téléphonique de l’Obersalzberg : le concert devait être répété le soir suivant. Et ce soir-là, qui allait être pour nous inoubliable, le Führer fut déjà dans la salle dix minutes avant le début du concert. Je montai sur scène et fixai mes musiciens pour les encourager tout en sachant que chacun allait donner le meilleur de lui-même. A la fin du concert, le Führer traversa les rangs du public en compagnie du camarade de parti Hess, jusqu’au podium. Je vins à sa rencontre. Il me tendit la main en me regardant profondément dans les yeux et me dit avec cœur : “Adam, je vous remercie !”. Je lui répondis : “Non, mon Führer, c’est moi qui vous remercie au nom de tout l’orchestre.” Le Führer ne me lâcha pas la main avant de déclarer : “A partir d’aujourd’hui, je m’engage personnellement envers mon orchestre !” »
 |
Franz Adam (à gauche, tenant une baguette) avec quelques
musiciens de l’orchestre de la radio de Munich, lors
d’une séance de lecture de partition.
|
Franz Adam avait dirigé l’
Orchestre Symphonique National-Socialiste du Reich dans la Quatrième Symphonie « Romantique » de Bruckner, si chère au cœur du Führer. Mais elle fut interprétée de manière tellement impressionnante que toute l’assistance en fut bouleversée et que le Führer remit spontanément au chef d’orchestre le bouquet de roses qu’il avait reçu à son arrivée au
Kursaal…
Dès le lendemain, un communiqué fut publié annonçant que l’orchestre serait désormais utilisé dans tout le Reich pour le rayonnement de la politique culturelle car « il est évident que de pareils concerts exercent une force d’attraction exceptionnelle et produisent une plus puissante impression que les réunions habituelles qui risquent de saturer le peuple ».
Quelques semaines plus tard, Adam rencontra à nouveau Hitler à Munich qui l’encouragea à faire de sa formation l’orchestre itinérant pour le développement de la culture du peuple, qu’il avait imaginé dans sa jeunesse. L’orchestre se mit immédiatement à l’ouvrage, sillonnant tout le Gau de Munich-Oberbayern: l’ « Orchestre du Führer » permit, à chaque concert, de drainer des foules immenses, bien au-delà du cercle des membres du parti.
Après la prise de pouvoir en 1933, Franz Adam devint responsable de la section « Musique et Cinéma » de l’Office culturel de Munich, en même temps que de l’Orchestre Philharmonique de Munich. Cependant, son engagement total dans le développement de l’Orchestre Symphonique National-Socialiste du Reich ne fit de ces fonctions que des titres honorifiques.
C’est ainsi que l’ « Orchestre du Führer » participa activement à l’animation musicale du Congrès (Reichsparteitage) de Nuremberg en 1933, 1934 et 1935 (créant, notamment, la
Festmusik du compositeur national-socialiste Albert Jung), avant de permettre aux autres orchestres du Reich – de plus grand renom– de s’y produire (
Gewandhausorchester de Leipzig,
Berliner Philharmoniker,
Münchener Philharmonische Orchester,
Wiener Philharmoniker,…).
En 1937, le nom de l’orchestre fut simplifié en
Orchestre Symphonique National-Socialiste : il était alors présent sur tous les fronts culturels, donnant des concerts dans tout le Reich et à travers toute l’Europe, dans les réunions de la Jeunesse, dans les usines, les hôpitaux, au cours de manifestations du Parti ou d’autres circonstances politiques.
Parmi les compositeurs contemporains –aujourd’hui rejetés dans l’oubli – dont il joua ou créa les œuvres, on peut citer Hermann Blume, Josef Reiter, Paul Höffer, Karl Höller, Friedrich Jung, Paul Scheinpflug, Max Seeboth, Rudolf Stephan ou Max Trapp.
Franz Adam adhéra à la
Sturmabteilung (SA) en 1933 ; en 1939, il en fut nommé
Sturmhauptführer et en 1942,
Sturmbannführer. En tant que responsable des questions musicales auprès de l’équipe des « conseillers du Führer », il avait un rang de direction à la NSDAP. Il était également conseiller présidentiel de la Chambre Musicale du Reich et membre du Sénat de la Chambre Culturelle du Reich.
Le 5 décembre 1941, il se remaria avec l’actrice Lieselotte Schmidt.
En août 1945, Franz Adam fut arrêté par les Américains à Garmisch-Partenkirchen et interné pendant trois ans dans différents camps où il perdit la santé. Privé de toute possibilité d’exercer son art, il accepta encore de donner quelque temps des cours de théorie musicale dans une école de musique américaine à Dachau. Il termina sa vie dans le dénuement total et, victime d’un accident vasculaire cérébral, il mourut à Munich, le 21 septembre 1954.
L’œuvre de Franz Adam en tant que compositeur est importante: de nombreux
Lieder et œuvres chorales, de la musique de chambre et pour orchestre à cordes ainsi que des poèmes symphoniques, de la musique de scène et une Symphonie en fa mineur. Si certaines œuvres furent interprétées par l’
Orchestre Symphonique National-Socialiste et probablement également enregistrées en même temps que certains concerts, aucune ne fut jamais diffusée par le disque.
(Source principale : Bayerisches Musiker-Lexikon Online)
 |
| Annonce d’un concert du « NS-Symphonie-Orchester » dans la presse d’Innsbruck. Organisé par le Gau Tyrol-Voralberg de la NSDAP, le Front Allemand du Travail et la Communauté Nationale-Socialiste « Kraft durch Freude », le concert –dirigé par le second de Franz Adam, Erich Kloss (1898-1967)– programmait la 88e Symphonie de Josef Haydn, la 5e Symphonie de Tchaïkovski et le 5e Concerto pour piano et orchestre de Beethoven (soliste : August Leopolder, 1905-2006) |