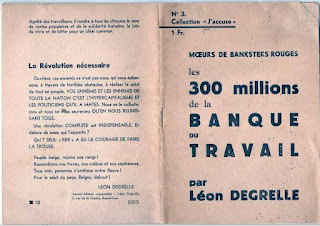Acte de naissance de Léon Degrelle
né en son domicile de la rue du Collège 25, à Bouillon, le vendredi 15 juin 1906, à 21h.
Marie Degrelle-Boever tient dans ses bras le petit Léon, son nouveau-né.
La photo est prise à l’occasion du baptême administré le mercredi 20 juin 1906 en l’église paroissiale Saints-Pierre-et-Paul de Bouillon par son oncle et parrain, l’abbé Joseph Boever (1874-1950), curé de Devantave (Marche-en-Famenne).
Un fleuve de noblesse et d'héroïsme devait rafraîchir nos pays jouisseurs, haineux, cramponnés à la bêtise de l'or vivant dans l'exclusivisme des appétits strictement personnels et matériels.
La Douleur avait fondu sur l'Europe, pareille aux malédictions antiques, comme un fabuleux ouragan tombant d'un ciel en feu.
Elle était venue, au-delà des villes consumées, des biens détruits, des cœurs broyés, pour ramener à l'essentiel: la primauté des âmes, la nécessité pour les peuples d'être purs, possédés par l'amour des autres, tendus vers le don de soi.
卐卐卐卐卐卐卐卐
Un fleuve de noblesse et d'héroïsme devait rafraîchir nos pays jouisseurs, haineux, cramponnés à la bêtise de l'or vivant dans l'exclusivisme des appétits strictement personnels et matériels.
La Douleur avait fondu sur l'Europe, pareille aux malédictions antiques, comme un fabuleux ouragan tombant d'un ciel en feu.
Elle était venue, au-delà des villes consumées, des biens détruits, des cœurs broyés, pour ramener à l'essentiel: la primauté des âmes, la nécessité pour les peuples d'être purs, possédés par l'amour des autres, tendus vers le don de soi.
(Léon Degrelle, Etat d'Ame, 1938)
卐卐卐卐卐卐卐卐
Médaille du centenaire